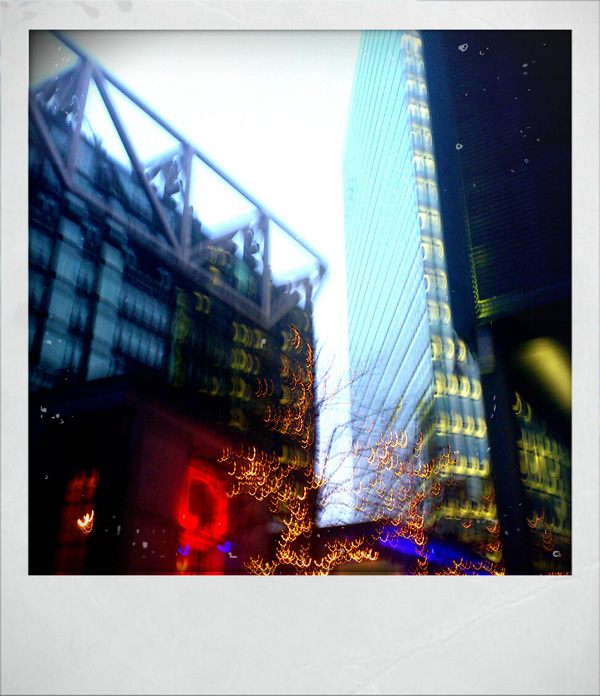La ville fond, les bonnets tombent, les gants ne sont plus de rigueur. Les berlinois sortent de leur tanière, et partout se promènent, sourire aux lèvres. La crispation constante due aux -18 degrés cède place à la détente. Ça fleurit.
Mes idées prisonnières de petits glaçons denses et bien sculptés dégèlent. Ce que j’ai vu et parcouru se ranime et travaille. Ça grouille et ça se bouscule au portillon !
Barbara de Christian Petzold
Je ne connais pas Christian Petzold. J’ai beau chercher sur la toile, aucun de ses trois films sortis en France ne me dit quelque chose. Antonia s’en étonne, m’assurant qu’il est l’un des réalisateurs allemands les plus en vogue du moment. Et que c’est un bon. Sur ce, je file voir Barbara (note : 5.4). Ce film est vaste. De ces films qui, par le biais d’une histoire toute singulière, cherchent à gagner l’ampleur de l’Histoire. Cela se sent, à tout instant. Le scénario est trop bien ficelé, tout s’imbrique avec une volonté d’hypermnésie permanente. La mise en scène, la lumière, les décors, les dialogues. Ça respire la justesse. Moins la maitrise (bien qu’elle existe) que le désir de travailler le spectre du passé (en l’occurrence l’Allemagne de l’Est dans les années 80) jusque dans ces détails les plus ténus, comme s’il y avait urgence à regarder autrement cette époque et malaise, encore aujourd’hui, à en gratter les couches superficielles. Je ne sais pas. Assurément, Barbara est un film allemand, pour les allemands. Il ne sort pas de ce cercle là. Il cherche trop à tout appréhender (en regardant par le petit bout de la lorgnette) et à tout faire savoir (s’excusant à demi, entre sentiment de prétention et conviction de nécessité). Depuis le début de la Berlinale, c’est le film le plus encensé et le mieux noté par les journalistes allemands. Les jours passent, cela persiste. Nul doute désormais : s’ils étaient décideurs, Barbara raflerait l’Ours, haut la main.
Assez questionnant n’est-ce pas ?
Cesare deve morire de Paolo e Vittorio Taviani

Les frères Taviani, eux, je les connais. Ils sortent de la grotte avec Cesare deve morire (note : 8.0), film distribué par la Sacher Films de Moretti. C’est amusant d’imaginer les liens que doivent entretenir ces trois là, depuis que l’énergumène Moretti, juvénile tout prétentieux qu’il était, s’est permis de vérifier la qualité du cadrage sur Saint Michel avait un coq (1971) alors qu’il n’était qu’un figurant inconnu au bataillon. Et Shakespeare s’en mêle qui plus est ! Je ne sais rien de plus avant la projection. Voyons voir…
Incroyable tentative, croisements fous. Tout n’est pas réussi, c’est parfois pesant. Mais ce qui se passe là est fichtrement intéressant.
Paolo et Vittorio Taviani entrent, un peu par hasard, dans les quartiers de haute sécurité de la prison de Rebibbia à Rome, et obtiennent l‘autorisation d’adapter avec une poignée de prisonniers le Jules César de Shakespeare, en collaboration avec le metteur en scène Fabio Cavalli, qui travaille chaque année sur une représentation avec les prisonniers. Ce qui donnera deux choses : une pièce de théâtre et ce film. Les acteurs sont tous des hommes enfermés, du cru, à l’exception relative de Salvatore Striano : enfermé, il ne l’est plus. Mais il le fut. Précisément dans cette prison. Il connaît ces cellules, ces cours, cette bibliothèque. Il connaît Cavalli, avec qui il a travaillé comme détenu d’abord, comme homme libre ensuite. Striano refoule le sol de Rebibbia cinq années après sa libération. Voilà le genre de mélanges que convoque ce film. Explosif.

Mon enthousiasme réside justement en cette faculté magique de glisser d’un lieu, d’un monde à l’autre sans que le premier soit effacé, mais au contraire, faisant en sorte qu’il enrichisse et ramifie le second. Dans cette manière de mixer les gens et les genres, sans qu’aucun ne soit préexistant. Dans cette capacité à la stase et au mouvement. Je m’explique : nous sommes en prison c’est certain, mais les murs s’élargissent, les couloirs, les escaliers, les cellules deviennent scène, déclencheurs, voire prétextes à initier une réplique, travailler son texte. Le spectateur s’échappe à maintes reprises, tout comme les prisonniers devenant complètement acteurs, dépouillés alors – aux yeux des spectateurs – de tout ressenti d’enfermement.
En même temps nous sommes en prison. Et nous y restons. Les doubles portes de chaque cellule sont verrouillées par des gardiens en uniforme, chacun est identifié en temps que criminel (nous apprenons par un pédigrée rapide, inscrit en lettres blanches typographiées sur le portrait en plan fixe de chaque détenu, la durée et le motif de leur peine), les horaires sont respectés.

Shakespeare est là. Mis en scène. Mais il laisse place au dialecte de chaque homme et provoque une liesse populaire, un florilège de sons incompréhensibles à vos oreilles. Pas si lointains pourtant, éveillant ce désir d’inconnu, le rendant presque palpable.
Il y a aussi le passage de la couleur au noir et blanc.
Il y a cette manière de poser la caméra, objective, comme preuve d’un délit ou d’une scène de crime. Preuve d’un « ça a été ». Et il y a sa façon de danser, de suivre, de faire confiance et de guider. De tenter l’aventure.
Il y a tout un monde de paradoxes liés, rapprochés, transformés en autre chose qu’une évidente dichotomie.
Il y a Salvatore Striano, devenu acteur, et tous les autres. Il y a cette dernière phrase d’un homme qui ne sera finalement jamais acteur, puisque jamais libéré : « Since I have known art, this cell has turn into prison ».
Ca a l’air un peu pompeux comme ça ? Venez, voyez, puis on en reparlera.
à suivre...