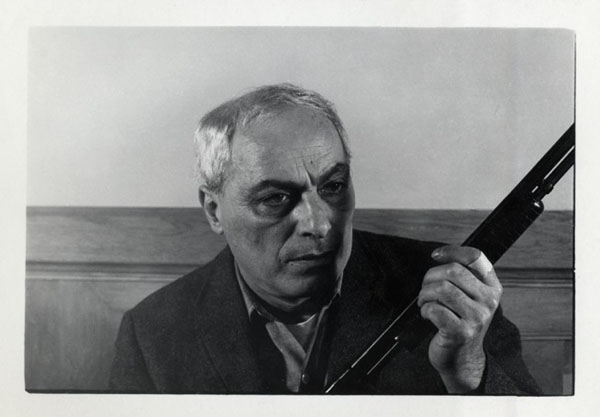L’aspect ludique de vos films n’amène-t-il pas nécessairement l’idée de la triche, de la contrefaçon ?
Ce sont des mots très chargés. La triche s’opère généralement pour son propre profit. Je la vois pour ma part comme une étape normale du processus qui peut effectivement être reliée à l’aspect ludique de mes films. Dans tout jeu, on peut tricher. On peut penser que je triche en représentant dans casting a glance (2007) la vie de la Spiral Jetty sur une année et demi, mais il s’agit plutôt d’une solution créative pour représenter l’Histoire. Au fond, ce n’est pas plus mensonger qu’un livre d’Histoire. C’est une technique. Quand j’ai commencé à copier des peintures folk, c’était parce que je ne pouvais pas me permettre d’acheter une peinture de Bill Traylor. Il est mort pauvre mais ses œuvres s’échangent maintenant à 90000$. Je n’en avais pas les moyens et je me suis dit que je n’avais qu’à peindre les miennes. Or on découvre vite que tricher nécessite beaucoup de travail ; aujourd’hui, il serait facile de croire que je possède de vrais toiles de Bill Traylor. Recréer des œuvres d’outsider est peut être la triche ultime : cela fait de quelqu’un comme moi un folk artist diplômé. Si je me suis parfois donné le nom de cinéaste folk, c’est évidemment encore un mensonge. C’est simplement continuer à suggérer que j’étais à l’époque aussi naïf qu’un outsider. Mais un film vient toujours d’une position privilégiée. Faire un film, c’est devenir un insider que vous le vouliez ou non.
Puisque vous en avez fait l’expérience pratique avec le remake en 2004 de One Way Boogie Woogie, y-a-t-il une différence entre filmer un paysage en 1977 et le filmer aujourd’hui ?
La plus grande différence c’est soi. Quand je suis retourné sur ces lieux, j’avais vraiment quelque chose à quoi me mesurer. J’ai réalisé à quel point j’en savais plus qu’à l’époque. Je pense beaucoup plus à ce que je fais aujourd’hui, au point parfois de m’encombrer. Dans un miroir, vous ne vous sentez jamais vieillir. C’est en retrouvant vos anciennes connaissances que le vieillissement vous frappe. L’expérience est toujours intéressante. Cela dit, l’Amérique a elle aussi beaucoup changé. En 1977, elle venait de perdre son innocence au Vietnam. J’ai récemment lu Travels with Charlie que Steinbeck a écrit en 1960, et Blue Highways de William Least Heat-Moon, qui date de 1977. Tous deux racontent un voyage à l’intérieur des Etats-Unis. Steinbeck emmène son chien Charlie et parle beaucoup du racisme. William Least Heat-Moon, qui a des origines indiennes, parle de la terre, de la ruralité. Il a plus tard écrit cet autre livre remarquable qu’est Prairy Earth. Entre ces deux livres, 1960 et 1977, la perte de l’innocence dûe à la guerre du Vietnam est frappante. Entre 1977 et 2004, date des deux One Way Boogie Woogie, nous n’avons plus connu une telle chose, mais le caractère maléfique de certains régimes ayant besoin du pouvoir économique pour dominer le monde devenait évident. Quand toute cette merde revient vers vous, même sous la forme d’un extrémisme religieux, c’est le monde qui apparait. L’Amérique a pu penser que le monde avait changé pour en arriver à de tels actes, mais ce n’est pas lui qui a changé. C’est une chose que je pouvais sentir entre les deux versions du film. Je ne faisais plus une comédie. Rien du genre de l’anecdote racontée tout à l’heure (voir épisode 4) à propos du tournage de 1977 ne m’est arrivé, à l’exception d’un propriétaire d’une décharge qui voulait se battre avec moi, sans doute parce qu’il y menait un commerce illégal. Juste un drôle d’affrontement qui a mené à une étrange paranoïa.
La récurrence du thème amérindien évoque The Exiles de Kent McKenzie. Une étude avait été menée sur la vie des amérindiens vivant à Los Angeles, avec de nombreuses interviews. Beaucoup d’entre eux parlaient de désorientation spatiale, de difficultés à marcher et à se repérer dans les villes. La plupart ne trouvaient le chemin de leur maison que parce qu’ils avaient mémorisé la forme du bus qui les y ramenait. Vous parlez beaucoup des amérindiens et de leur rapport très particulier au paysage.
Je n’ai pas fait beaucoup de recherches sur les Navajos et leur mythes soi-disant créationnistes, qui ne sont bien sûr pas plus créationnistes que la Bible. Mais j’aime la façon dont ils occupent les paysages. Les Indiens Anasazi logent par exemple dans des falaises et des canyons, et conçoivent des maisons immenses pour observer la façon dont bougent le soleil et la lune. Je me suis surtout intéressé à la façon dont l’Amérique a grandi avec la notion de Destin manifeste. Cette idée que la nation américaine devait répandre la démocratie et la civilisation dans l’Ouest en décrétant au préalable que cette terre était la sienne. Comment une nation peut-elle se développer sur une terre sans aucune tolérance pour ceux qui l’occupaient avant eux ? Le pays entier s’est construit sur un génocide légitimé par l’idée que Dieu serait de notre côté. Ce "thème" est présent dans de nombreux films. Deseret (1995) bien sûr. Ou Four Corners (1997), qui commence par l’histoire européenne avant d’en venir à celle des Indiens. J’utilise d’abord Monet et sa biographie comme celle d’un stéréotype européen. A l’opposé, le héros est un peintre fictif, une figure réelle mais romancée, qui peignait sur les murs et les canyons du Colorado. Les gens qui étudient ces dessins soutiennent qu’ils ont été faits par un homme, mais les mêmes motifs se retrouvent sur des poteries, toutes censées êtres faites par des femmes. J’ai fait donc fait de cet artiste une femme, ce qui est à la fois un mensonge et une supposition vraisemblable.
Vous citiez Tati et Bresson, y a-t-il d’autres cinéastes qui vous aient frappés ou influencés ?
Mes principales influences sont Snow, Frampton et Warhol. Mais parce que je suis autodidacte et que mes premiers films venaient de ce que je pouvais comprendre du fonctionnement d’une caméra, chaque nouveau film est surtout influencé par le précédent. A chaque film, ce que j’apprends sert le suivant. Cette continuité entre les films se remarque aisément. Cela dit, personne ne peut nier ses influences. Par un auteur aussi bien que par la publicité. J’ai peu d’amour pour le cinéma narratif traditionnel. Mais étant donné que j’enseigne dans une école d’art, CalArts, et que certains de mes collègues sont de très bons programmateurs, je vois généralement un bon film par semaine. Ce sont généralement des films du tiers-monde ou des hybrides entre fiction et documentaire. Ils m’influencent sans doute indirectement. Le cinéma hollywoodien m’est en revanche passé complètement à côté, sauf dans l’avion. J’ai probablement vu tous les films de Julia Roberts sans le son. Ainsi je peux au moins reconstruire mes propres récits. Plus sérieusement, mon modèle de film narratif serait Profession Reporter. Et d’autres classiques comme La Prisonnière du désert ou Conversation secrète.
Dans le processus d’approche du paysage, cherchez-vous à rester neutre, impersonnel ? A effacer vos idées, vos préjugés ?
Je suis au contraire très conscient du fait d’être dans un espace. Je veux précisément recréer le sentiment de ma présence. La puissance du paysage ne peut qu’être celle que j’y perçois. Tout l’opposé de la neutralité.
Des paysages sont cependant parfois si puissants et chargés émotionnellement qu’il suffit peut-être d’être là ?
Mais je dois toujours savoir quelque chose, par exemple d’ordre géologique, pour me repérer et reconnaître l’origine d’une cicatrice, d’un sillon creusé par les mormons. C’est aussi comme cela que je trouve un sens et une direction. La manière dont je trouve les plans n’est en revanche pas du détachement, plutôt un vrai attachement.
Avez-vous vu Aka. Serial killer (1969) de Masao Adachi, qui développe une théorie du paysage qui est en même temps un manifeste politique selon lequel le paysage est fondamentalement lié au pouvoir dominant ? Le film est uniquement constitué de paysages qu’a traversé un tueur en série. Il dit que le paysage est déjà si chargé en puissance, en meurtres, qu’en regardant simplement un paysage traversé par un assassin vous verriez ce potentiel de meurtre.
Il me semble avoir déjà entendu quelqu’un me le décrire, tant cela ressemble évidemment à Landscape Suicide.
Quel rapport établissez-vous entre le meurtre et le paysage ?
Je fais une connexion directe entre le paysage physique et le paysage psychologique. Les deux meurtres de Landscape Suicide ont tous deux à voir avec l’isolement. Un en Californie où une jeune fille, isolée en raison de sa classe sociale, ayant déménagé avec sa famille dans un quartier riche, finit par commettre un meurtre. Celui-ci est donc d’un manière ou d’une autre lié à ce paysage beau et primitif des banlieues nord-californiennes de San Francisco. Et l’autre histoire est celle d’Ed Gein, qui vivait dans une ferme du Wisconsin totalement isolée par l’hiver, et dont tout le monde pensait qu’il était un vieil ermite ; il va tuer deux femmes en un an dans la ville voisine. Isolements physique et social qui me permettaient de connecter ces deux histoires. La première partie montre la jeune fille avouer son meurtre, puis le paysage. La seconde partie montre le paysage avant de voir la transcription rejouée du procès de Gein. Une attente a été crée, on sait à quoi s’attendre.
Quelle est l’importance de Thoreau dans votre vie, dans votre travail ?
Je l’ai lu très tôt au lycée mais n’en avais aucun souvenir. Je l’ai relu à la fin des années 1990 alors que je me trouvais en Corée du sud. Walden ou la vie dans les bois était l’un des seuls livres anglais disponibles à la bibliothèque. Tout à coup, Thoreau décrivait ma pratique du film. Notamment dans le chapitre intitulé “Bruits” (“Sound”). Il y parle notamment des trains qu’il entendait depuis sa cabane, ce qui me parle encore plus depuis que j’ai fait RR (2007). Le livre préfigure en quelque sorte le film. Quatre ou cinq ans plus tard, j’ai entamé ce cours à Cal Arts intitulé “Looking and listening”, où j’emmène les étudiants dans la nature pour leur apprendre à prêter attention. Je leur demande d’écrire des descriptions d’un film qu’ils pourraient faire à partir de leur observation. L’année dernière, quand j’ai décidé de reconstruire la cabane de Walden, je me suis rendu compte des connexions qu’il y avait entre ce cours et le fait de construire une cabane. Je vivais au milieu de nulle part et repensais à cette notion d’outsider. Je voulais refaire ce que Thoreau avait fait dans le passé. J’ai donc relu Walden et le premier paragraphe de “Bruits” ressemblait exactement aux descriptions que nous faisions pendant le cours. Je pouvais alors vraiment dire qu’il m’avait influencé. J’ai dû traverser tout ce processus pour vraiment comprendre ce chapitre comme je le comprends maintenant. Il parle notamment d’un moment où, assis sur le porche, il réalise que le soleil vient d’apparaître dans une fenêtre qui lui indique qu’il a passé là tout l’après-midi. Sept heures à prêter attention. C’est ce genre de temps auquel je désire arriver.
Il y a aussi chez Thoreau l’idée que l’attention serait en elle-même une attitude politique.
Je ne suis pas assez familier des idées de Thoreau sur la désobéissance civile pour en parler, mais je sais à quel point il cherchait à être juste par rapport à ses idées. Kasczinski aussi, jusqu’au point de tuer pour les défendre. Cela le rend très différent des tueurs en série motivés par des fantasmes sexuels ou des pulsions. Je ne pourrais jamais justifier ses actions mais on ne peut pas faire comme s’il tuait pour des raisons pulsionnelles ou économiques.
Je trouve vraiment déprimant que les Démocrates n’aient pas su, dans la course à la présidence, rester les radicaux qu’ils furent. Jeune, Hillary Clinton était vraiment radicale. Mais elle a si bien étudié les rouages du système qu’elle est devenue une vraie politicienne. C’est peut-être de l’intelligence et la seule manière d’arriver au pouvoir, il n’empêche. Qu’Obama, vraiment admirable pour son travail contre la pauvreté dans les quartiers à l’extérieur de Chicago, donne la parole à ce prêtre et à son foutu discours sur l’Amérique était décevant. On verra ce qu’il va se passer. Mais le corporatisme est aussi puissant que l’espoir est mince.
Pensez vous être arrivé à la fin d’un cycle ? Avez vous une idée de ce qui va venir ?
Je ne pense pas que mon prochain film sera très différent. Mais il s’agira d’un autre pays et d’un autre médium. Je vais tourner en Allemagne. Et en numérique. Un film sur la classe ouvrière, comment elle supporte la culture, comment il ne peut pas y avoir de culture sans travail. Le numérique sera sans doute une découverte. Même si je ne me fais pas d’illusions. Il y aura d’autres problèmes, notamment de projection. Je repense au bonheur que j’avais à projeter mes films 8mm sur le côté de mon réfrigérateur pour des amis. Nous buvions de la bière et riions. Pourquoi ne pourrais-je plus le faire ? Je pourrais trouver des musées qui me permettraient de construire une salle où l’on puisse retrouver ce sentiment d’intimité. Quatre ou cinq personnes ensemble devant un film.
Entretien réalisé le 11 juin 2008 à Serpa (Portugal) par Cyril Neyrat et Ricardo Matos-Cabo. Traduit de l’américain et mis en forme par Antoine Thirion