Où il est question de...
Tsili d’Amos Gitaï
2.9
Near Death Experience de Benoît Delépine et Gustave Kervern
3.8
O Velho do Restelo de Manoel de Oliveira
8.5
Hill of Freedom de Hong Sang-Soo
7.7
Juger les couvertures
Marques enfin prises, une idée s’installe. Les jours sont comptés, les choses sérieuses commencent, le temps manque déjà. La foule toute relative du week-end n’est plus là, elle n’a pas laissé de traces, comme si le festival s’était chargé de faire le tri. Puisque les grands rendez-vous internationaux sont affaire de haut niveau et de hautes sphères, ils accueillent toujours quelques films qui viennent explicitement le rappeler, souvent sans succès ni sens du ridicule - ainsi de Sils Maria cette année à Cannes. Venise 2014 n’échappe pas à la règle : Oliveira et Hong Sang-Soo, Gitaï - déjà présent l’an dernier avec Ana Arabia - pour commencer. Le résultat est plus heureux, cette belle redécouverte de la Mostra dure deux jours.

Cela ne partait pourtant pas très bien. Amos Gitaï vient en habitué ; à Paris, Ana Arabia est sorti il y a deux semaines. On ne peut croire qu’un cinéaste comme lui puisse provoquer une overdose chez le spectateur, mais en tout cas, personne ne l’attendait. On va voir un film de Gitaï par devoir, ou presque, en compagnie de quelques personnes qui se répartissent de manière à ce que la salle soit bien couverte. Tsili n’est d’ailleurs pas étranger au sens du devoir. Il y est question d’une jeune héroïne juive d’Europe de l’Est, qui échappe aux persécutions durant la seconde guerre mondiale en se réfugiant dans une forêt. Rejointe par un jeune homme juif lui aussi, elle vit avec lui un temps, avant qu’il ne disparaisse. Même quand ses films sont des hybridations entre danse, théâtre et cinéma, il y a chez Gitaï un idéal de pureté, où l’image reste immaculée et n’attend qu’une salissure pour que le récit enfin avance. Pourtant, cet idéal ne souffre aucune invasion, aucune contamination par l’extérieur, tout va bien à condition que l’image numérique ne soit pas troublée par une figure floue ou un son un peu saturé. C’est ainsi qu’on attend dix bonnes minutes que tout commence, après une séquence d’ouverture durant laquelle on voit l’héroïne danser sur fond noir, au son d’un morceau classique, puis un long plan sur la jeune femme, qui erre dans des buissons. La suite est l’inverse d’une autre méthode, celle de Straub/Huillet : dans Lothringen !, où les bruits de la guerre faisaient également rage, dans un plan montrant une carte de la Lorraine, ces derniers ne chargeaient pas l’image d’impureté, mais rendaient cette image au monde des sons. Chez Gitaï, tout est découpé et segmenté, et un mur sépare l’une des autres. Il en va ainsi de son découpage en plusieurs parties distinctes, bien qu’elles ne soient pas explicitées : l’errance solitaire de la jeune fille, sa rencontre avec un homme, le viol qu’il commet sur elle, qui fait passer l’impureté dans le scénario, sa disparition, l’arrivée dans le camp où sont regroupés les autres Juifs. Il n’y a pas qu’un imaginaire de l’ordre qui est à l’oeuvre, mais aussi un fantasme de l’origine, développé dans les différentes parties : la danse comme origine du mouvement d’abord, puis un plan fixe sur la jeune femme innocente comme image originelle, immaculée, et enfin la Terre Promise, où tout est à recommencer.
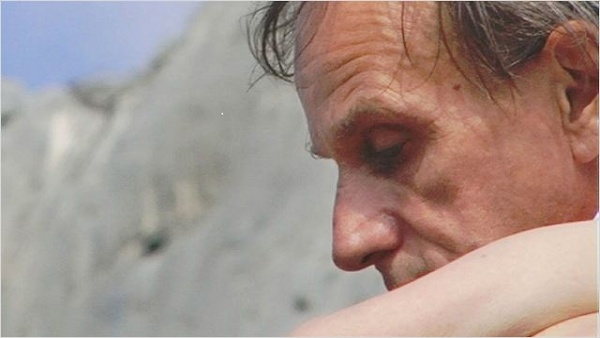
Tout a une fin, néanmoins, même la vie de Michel Houellebecq, qui incarne Paul, le personnage principal de Near Death Experience de Gustave Kervern et Benoît Delépine. Dépressif ou simplement las de ceux qu’il fréquente, famille et collègues, Paul part faire du vélo dans les montagnes, cherchant la mort. Ne parvenant pas à se suicider - c’est un problème pratique, pas psychologique, tous les moyens ne sont visiblement pas bons - il se déclare décédé et erre sur des plateaux déserts. Si Houellebecq apparaît marginal dans le film, c’est à l’image de sa marginalité dans le monde consensuel de la littérature française contemporaine. L’écrivain s’est façonné une position dans cet univers, dont son personnage et les deux cinéastes tirent tous les bénéfices. Pas besoin de présenter Paul, qui est Michel Houellebecq autant que ce dernier joue un personnage. L’image granuleuse, imprécise, presque floue, met tout à plat : le protagoniste n’est qu’une affiche commerciale parmi d’autres, comme un long plan fixe nous le montre, où Houellebecq est encadré par deux grands panneaux publicitaires. Il en va de même du motif le plus clair du film, le maillot de cycliste rouge de Paul. En voyant cette tâche de couleur vive sillonner le cadre, on repense à la phrase la plus fameuse du dernier roman de MH : “la carte est plus intéressante que le territoire”, bon slogan qui ne trouve d’ailleurs pas de vrai développement dans le livre. Le maillot rouge dessine lui aussi une banderole de la même couleur qui ressemble plus aux bandeaux qui ornent les prix Goncourt qu’à une carte constituée de la litanie de plans sur la longue marche de Paul. Celle-ci est d’ailleurs soutenue par une voix off qu’on dirait tout droit sortie d’un monologue rédigé par l’écrivain Houellebecq. Si motifs et figures sont autant mis à plat par le film, c’est peut-être parce qu’ils sont faits pour aller sur du papier. La voix off de Paul n’est qu’une prosopopée, mais l’acteur et son personnage sont déjà ailleurs, au Paradis, définitivement à part : même avant son escapade, Paul ne répondait pas à ceux qui lui disaient bonjour, comme si en chacun se dissimulait un fan rêvant d’un autographe, mal déguisé en personnage de fiction.
Comme les films français en ont pris l’habitude, le générique de fin de Near Death Experience est accompagné par des sifflets. En revanche, on n’en a pas fini avec la littérature, et cette fois-ci, un court-métrage fait se remplir la même salle où passait NDE. O Velho do Restelo de Manoel de Oliveira est le film le plus court vu ici, à la fois le plus rapide, le plus séduisant, et le plus beau. Il va bien au Lido et à la Mostra. Ce court-métrage surprend par sa forme modeste qui a la force d’un théorème. La propriété pourrait s’énoncer ainsi : si un livre est une bouteille à la mer, un film est une carte postale. Le livre, c’est d’abord Don Quichotte ; les films, ceux d’Oliveira, dont Non ou la vaine gloire de commander et Le Cinquième Empire, mais aussi le Don Quichotte de Grigori Kozintsev. Le dispositif est simple et clair : dans un jardin contemporain, Don Quichotte et trois écrivains portugais (Teixeira de Pascoaes, Camoes et Camilo Castelo Branco) reviennent sur l’histoire du Portugal, dont l’évocation se traduit à l’écran par des extraits de films. O Velho do Restelo respecte son théorème, les livres y sont jetés à la mer, réellement mais aussi métaphoriquement, c’est-à-dire qu’ils sont faits pour voyager dans le réel, ce qui explique qu’un personnage de fiction puisse rencontrer des auteurs du XIXe et XXe siècles en 2014 ; à leur tour, les films donnent des nouvelles des lieux où les livres n’échouent pas. Le corollaire de cette propriété, c’est qu’un film qui s’accorde avec elle devient une oeuvre d’aventure. La vitesse qu’il acquiert est celle des multiples allers-retours entre la fiction et l’histoire, le passé et le présent. Il enchaîne les formulations de propriétés comme dans une démonstration mathématique, mais c’est plus affaire de rythme que de cohérence. Ce qui intéresse Oliveira, c’est comment une image plus ancienne peut en rattraper une plus récente parce qu’elle est plus rapide, ce qui fait qu’un film est un souvenir plus ou moins vivace parce qu’il prend plus ou moins son temps. Finalement, c’est une histoire de couverture : quelle image représente un roman, quelle phrase commence la fiction, grâce à quel plan se souvient-on d’un film ? Une oeuvre se juge à sa couverture, parce que elle est à la fois une porte d’entrée et la chose la plus simple à changer, une affaire d’élection. Ainsi, c’est l’image la plus récente, celle de la réunion de Don Quichotte et des écrivains, qui forme la couverture du film, dont le générique défile sur celle du roman de Cervantes. Peut-être parce qu’on peut imaginer une suite à leurs conversations, qui sont à la fois une porte d’entrée dans la fiction et une ouverture pour des discussions à venir.

La journée se termine avec Hong Sang-Soo, dont les derniers films, aussi bien Haewon et les hommes que Sunhi, ressemblent à des enchaînements de fin d’après-midi, qu’on reconnaît autant à la lumière qu’à la lassitude progressive des personnages. L’automne est la meilleure saison pour voir un film du Sud-Coréen, et Hill of Freedom prend un peu d’avance mais est en harmonie avec le rafraîchissement constaté à Venise. A regarder chaque personne qui s’installe dans la salle, on voit que tout le monde se sent chez soi, mais ce confort qui fait qu’on a envie d’habiter les oeuvres de HSS s’estompe maintenant de film en film. Les raisons en sont incertaines, et on attend de Hill of Freedom qu’il nous invite de nouveau à franchir le pas de la porte, ou qu’il nous en éloigne définitivement. A la fin de la séance, l’incertitude demeure sans être désagréable comme le passage de l’été à l’automne. Un jeune Japonais vient en Corée du Sud retrouver une femme dont il est amoureux et qui l’aime en retour. Sans indices pour accomplir ce pourquoi il est venu, il erre dans la ville, rencontre une femme avec qui il couche, un homme avec qui il boit, et rêve beaucoup. Le film n’avance qu’à la mise en oeuvre d’une tension entre, d’une part, la langue majoritairement utilisée par les personnages, l’anglais comme lingua franca et instrument privilégié de la liberté de mouvement et de dialogue avec les autres, et d’autre part l’étirement des plans, qui traînent souvent avec eux des motifs encombrants. Si l’anglais international libère les personnages autant qu’il les déracine (un homme fait remarquer au héros japonais qu’il ressemble finalement à un Coréen, avant que les deux ne se décrivent mutuellement comme des “Chinois”, l’amalgame habituel pratiqué par les Occidentaux), la longueur d’une scène les colle au bitume, à une chaise, à un banc ou un lit. C’est le rythme de l’anglais qui contrevient à l’usage que Hong Sang-Soo fait de ses images, où on voit désormais de moins en moins de zooms : Sunhi a entamé la désescalade, mais Haewon les réservait déjà à un plan sur une cigarette écrasée qui revenait plusieurs fois dans le film. A nouvel idiome, nouvelle manière d’être. L’entre-deux règne, c’est la transition qui dure. Entre un plan et le suivant, on ne sait plus si c’est une ellipse, un flash-back qui ont eu lieu, ou bien quelques secondes qui ont passé. Rien ne vient en effet ordonner le récit, seuls quelques repères spatiaux rassurent : la “colline de la liberté” est en fait un bar, un lieu routinier où le protagoniste entame malgré lui une éphémère relation avec une femme. Entre eux, la conversation est pourtant idéale : elle le flatte en anglais, il sourit poliment. Mais cette bonne communication ne résiste pas au désir d’une scène de venir perturber la chronologie en se transformant en rêve. C’est dans Haewon que les rêves se lançaient à l’assaut de chaque séquence, quand l’héroïne s’assoupissait sur un livre de Norbert Elias. Pourtant, chez HSS, les rêves ne sont pas sujets à interprétation, ils sont eux aussi le mode d’existence de certaines séquences comme le zoom est une manière de faire. Ils n’ont pas besoin d’être traduits, comme l’anglais pratiqué par les personnages. Finalement, les rêves anglophones annoncent peut-être les contours d’un nouveau monde, pas encore clairement défini, que le cinéaste aménage déjà mais dont on ne peut entrevoir que quelques recoins.
Ce serait heureux. De même qu’au moment de quitter Venise, que la ville et le festival changent de nouveau.
A suivre...



