Chacun des deux livres commence par un long entretien au contenu plus biographique que thétique, visant à justifier, d’une part, une cinéphilie, de l’autre, une discursivité – et, plus généralement, à rapporter ces textes à leurs origines. C’est qu’il s’agit, dans les deux cas, d’écrits de circonstances, articles, conférences, extraits de livres, et non d’un réel projet de recherche orienté autour du cinéma comme astre central. Il y a un certain malaise à ouvrir une somme faite uniquement d’orbites périphériques, donnant le sentiment que l’énonciateur vaut plus que l’énoncé, que le sceau seul donne son prix au cachet. Qu’à cela ne tienne, on continue la lecture.
Celle du livre de Badiou est, malgré tout, rapidement émerveillée. Les quatre-cents pages de la chose, si elles ne sont pas emportées par un grand mouvement systématique, ont l’intérêt d’aborder le cinéma sous différents angles. Des très beaux commentaires d’œuvres classiques (L’aurore et la forme du Deux, Tout va bien et l’élégie du gauchisme, Passion et la synthèse des arts, d’autres encore) mêlent avec brio envol des concepts et plongée dans la matière filmique. D’autres textes, nés pendant la ferveur des années militantes, abordent des séries de films selon la bonne vieille analyse idéologique, cherchant sous le masque du divertissement la configuration d’un monde voulu figé. Un court et drôlatique pamphlet s’attaque ainsi à la tradition comique française, à son poujadisme larvaire et à sa réduction du social à une typologie pittoresque dénuée d’enjeux autres que la culture d’un ressentiment anti-politique. Quelques essais épars tentent de ressaisir succinctement les éléments constitutifs des grandes phases de l’histoire du cinéma (« Repères sur la seconde modernité cinématographique »). Un texte plus général, « Du cinéma comme emblème démocratique », interroge le rapport du septième art à ceux qui le précèdent : question classique, mais dont les coordonnées sont ici reconfigurées puisqu’il est posé que, « art des masses », le cinéma reprend tous les autres arts mais seulement ce qui en eux est destiné à « l’humanité générique », et par là « assure la popularisation de tous les arts », fort de sa « vocation universelle ». S’ensuit une beau renouvellement de la question de « l’art impur » : le cinéma ne l’est pas, comme le voulait Bazin, parce qu’il se compose de tous les arts, mais parce qu’il ne cesse d’accueillir en lui le non-art, l’imagerie ambiante, les stéréotypes, bref, parce qu’il trouve sa matière même dans tout ce que l’art avait auparavant rejeté hors de ses frontières.
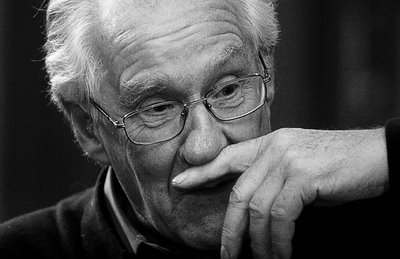
L’entreprise philosophique de Badiou a consisté à relire Platon à la lumière de Lénine, à chercher comment l’Idée s’actualisait comme événement, comment la theoria traçait la voie du communisme. Appliquée au cinéma, la question devient : comment le cinéma fait-il advenir des idées ? « Organiser l’effleurement interne au visible du passage de l’idée, voilà l’opération du cinéma », ce que Badiou appelle « visitation ». Le cinéma met en mouvement des idées, en fait des formes élusives qui nous traversent sans durer. Ce qui permet au philosophe de dire, dans le plus long et le plus beau texte du recueil, que le cinéma est une « expérimentation philosophique », dans laquelle la philosophie éprouve son manque plutôt que sa puissance, et découvre la voie de nouveaux moyens d’expression. « La relation [entre cinéma et philosophie] n’est pas une relation de connaissance. La philosophie ne permet pas de connaître le cinéma. C’est une relation vivante, concrète, une relation de transformation. Le cinéma transforme la philosophie. C’est-à-dire que le cinéma transforme la notion même d’idée. » Il est « situation philosophique », dispositif qui permet de mettre en rapport des termes étrangers l’un à l’autre. Badiou le montre avec, entre autres, une analyse de Matrix, Cube et ExistenZ, identifiant ces films de science-fiction à la démonstration logique des conséquences d’axiomes sur l’ordre du monde et des apparences. Bref, le philosophe fait œuvre d’épistémologie ; il ne se contente pas d’égréner quelques commentaires sur tel ou tel film, mais se demande, avec une réelle rigueur, à quel titre un discours sur le cinéma est possible, et quelle forme peut-il prendre.

C’est cette dimension qui manque au livre, bien moins épais, de Rosset. Ses Propos sur le cinéma ressemblent à un chapelet de sorties verbales faites en passant, sans s’arrêter sur son objet. L’entretien liminaire, qui occupe la moitié de l’ouvrage, est relativement pauvre ; son seul intérêt est de voir comment un schopenhaurien, fixé sur les questions du non-sens et de l’absurde, congédie à ce titre une grande part de l’histoire du cinéma justement parce que les films, passées la première aurore du burlesque, ont trop voulu faire sens. Le western et son lyrisme des communautés et des plaines est uniment condamné pour sa « morale conservatrice ». On se demande alors ce que le philosophe voit dans un film ; et, à voir les commentaires qui forment la seconde partie de l’ouvrage, on se dit : sûrement pas les images. Le livre pèche par un manque analytique certain. L’intérêt est ailleurs, dans des réflexions trop générales mais ouvrant quelques pistes sur la question du réel au cinéma, du rapport qu’il entretient avec ce réel qu’il prétend enregistrer tel quel. L’auteur du Réel et son double trouve dans le cinéma non un décalque ou une négation du réel, mais une sorte d’écart dialectique qui trouve sa formule dans l’idée d’outre-monde, de « l’autre réalité » : « de tous les arts, le cinéma est celui qui entretient le moins de rapports avec la réalité : pour appartenir essentiellement non au domaine du réel, mais à l’univers de ses doubles. » Un chapitre sur René Clair, le seul où les films sont réellement commentés, analyse ainsi les formes de l’onirisme dans l’œuvre muette du cinéaste, cherchant à montrer que le cinéma, plutôt qu’il ne reconfigure la réalité, témoigne de notre impuissance à l’atteindre. Le dernier texte, « L’objet cinématographique » – le seul réellement dense – montre que deux voies sont ouvertes au cinéma, le fantastique et le réalisme intégral. Le premier n’est pas la simple négation du réel, « mais son altération : non pas la contradiction du réel, mais sa subversion », et n’a de valeur que parce qu’il travaille cet interstice. Le second n’est intégral que dans la mesure où il ne prétend pas embrasser l’étendue de la réalité, mais où il manifeste que le réel est idiot, insignifiant, toujours singulier, jamais extensible, qu’il est un hic et nunc sans valeur. Rosset voit dans Godard l’emblème de ce cinéma déictique, qui montre sans commenter tout en révélant l’agglutination permanente de phantasmes venant adhérer à cette chose sans visage qu’est le réel. Il y aurait là de quoi renouveler les théories du réalisme au cinéma, mais l’approche de Rosset reste embryonnaire.
En dehors de leur (non-)intérêt intrinsèque, ces deux livres éclairent une certaine tendance du milieu éditorial. On imagine mal, au début du siècle dernier, la publication de recueils de Brunschvicg ou Bachelard sur le cinéma ; même les textes d’Elie Faure, dont les premiers datent des années vingt, ont du attendre jusqu’à il y a peu pour bénéficier d’une publication en un seul volume. Le mouvement s’est inversé : toute miette philosophique, qu’elle s’accroche au cinéma ou se contente de le survoler, semble bonne à publier. Longtemps, la littérature puis la linguistique ont été les deux organes théoriques de légitimation du cinéma, les deux instances discursives qui l’ont enveloppé. La philosophie les a supplantées. Dans ce renouveau perce parfois une tendance commerciale à vouloir marier le socialement noble (la philosophie) et ignoble (le cinéma), dont Ollivier Pourriol et sa pseudo-ciné-philo, emblème de la pédagogie du « apprendre en s’amusant », est le plus grand symptôme. Même dans des ouvrages aussi riches et rigoureux que Matrix, machine philosophique (publié il y a quelques années par une bande de jeunes chercheurs), l’échange est inégal : il s’agit toujours d’élever le cinéma à une dignité que seul la philosophie semble pouvoir lui conférer. L’entrain des éditeurs prêts à publier un livre aussi pauvre que celui de Rosset – et aux PUF ! – révèle à la fois un changement et une continuité dans l’ordre de la domination culturelle : le cinéma est devenu, plus que jamais, un « bon » objet de discours ; mais il ne l’est que dans la mesure où il accepte de se plier à toutes sortes de propos sans grands égards pour sa personne. Le discours semble rester plus important que le film. Rien de désastreux : nous avons besoin de mots pour nos images, et des livres comme celui de Badiou nous en apportent beaucoup ; mais le cinéma semble être voué à ne jamais sortir de son état de minorité.

