#1
Le Fils de Saul et Sortir du noir sont des oeuvres qui ont un double aspect. Cette dualité est d’ailleurs la même du film au livre : le premier aspect est réaliste et historique, le second traite de l’attrait de la fiction et de l’imaginaire. Dans le film de Nemes, ils sont entremêlés ; dans le livre de Didi-Huberman, ils sont séparés l’un de l’autre. Peut-être est-ce normal, puisqu’on a d’un côté affaire à un long métrage de fiction, et de l’autre à un essai sur celui-ci. Le livre se doit sans doute d’être plus didactique. Mais il ne faut pas oublier que l’historien de l’art a toujours eu tendance à faire de chaque ouvrage le double d’un précédent : ainsi de Devant l’image et Devant le temps, de Quand les images prennent position et Remontages du temps subi, ou encore de Ecorces et, justement, Sortir du noir.
#2
Les deux parties sont donc nécessairement imbriquées, et en réalité disent la même chose. Le film de Laszlo Nemes raconte, d’abord, cette imbrication. Saul Ausländer, membre du Sonderkommando du camp d’Auschwitz, croit reconnaître parmi les cadavres le corps de son fils après le gazage de dizaines de Juifs dans une chambre à gaz. Le doute sur la réalité de cette filiation s’installe vite, tant les autres membres du Sonderkommando rappellent à de nombreuses reprises qu’à leur connaissance, Saul n’a pas de fils. Toujours est-il que le protagoniste n’a qu’un but : enterrer le corps en bonne et due forme, et trouver un rabbin pour prononcer le kaddish, quand bien même la présence de ce dernier lors de cette prière pour les morts n’est pas requise dans les rites funéraires juifs. Le récit se déroule sur deux jours ; Saul est sans cesse en mouvement, va d’un endroit à l’autre, subit brimades et humiliations, se voit confier des tâches complexes, risque sa peau plusieurs fois. Mais c’est en fantôme qu’il traverse les deux événements historiques capitaux qu’aborde le film : la prise de quatre photographies de l’intérieur du camp par un membre du Sonderkommando, et la révolte menée à Auschwitz par le Sonderkommando lui-même en octobre 1944. Il faut enfin dire comment tout cela est montré : la caméra suit Saul, souvent de dos, parfois de face, mais ne le lâche jamais, à tel point qu’il obstrue significativement le champ. Le décor du camp apparaît alors, la plupart du temps, flou. Le travail du son se charge d’évoquer la cacophonie qui règne dans le camp, une surprise pour ceux qui croyaient qu’Auschwitz était un enfer silencieux, mais une confirmation pour ceux qui savaient ce qu’impliquait en terme de nuisance sonore la proximité de l’usine IG-Farben de Monowitz.
#3
Que dit Sortir du noir ? Deux choses : que la fiction réaliste et documentée pouvait seule raconter ces 48 heures, de manière à nous sortir de l’horreur (fiction) tout en nous y faisant entrer (réalisme) ; que le style de Nemes relève en réalité autant d’une approche méticuleuse, historique et documentaire de la fiction que du conte, et en particulier d’une approche culturellement juive de celui-ci. Evoquant Kafka et Benjamin, Didi-Huberman forge la notion de “conte documentaire”. La première proposition rejoint l’idée de la seule représentation possible, de l’idéalité du filmage ; la seconde parle d’un style unique, d’une invention primordiale. La combinaison des deux ne laisse aucune place au doute : non seulement, comme la Shoah, l’invention de Nemes est un événement unique, mais c’est en plus la seule manière d’appréhender l’extermination. Le repli de la description du film sur celle de l’événement qui en constitue le coeur aurait dû interpeller tout le monde, comme la stupéfiante convergence intellectuelle de deux adversaires historiques dès lors qu’on évoque la représentation de l’extermination des juifs d’Europe : Georges Didi-Huberman et Claude Lanzmann.
#4
Que dit Claude Lanzmann du Fils de Saul ? Que le film, en réalité, ne parle pas de la Shoah, prenant ainsi au pied de la lettre les procédés esthétiques du film. Puisque le camp et l’extermination sont dans le flou, Auschwitz, le génocide, le Sonderkommando ne peuvent être le sujet véritable du film. Loin d’être radical, Lanzmann réconcilie ainsi les raisons de toutes les positions favorables au Fils de Saul. Il satisfait les partisans de “la seule représentation possible” quand il dit, dans un entretien à Télérama, qu’il s’agit d’un film qui arrive à contourner le sujet, tout en en faisant son cadre. Il satisfait aussi ceux qui affirment qu’on peut et qu’on doit faire des fictions sur la Shoah, à condition qu’on ne s’appelle pas Spielberg ou Benigni et qu’on ne prétende pas, comme eux, montrer l’horreur des camps sans jouer sur les focales. Il contente enfin ceux, peut-être plus rares, qui attendaient une caution historique, politique et morale à l’attrait qu’exerçait sur eux le film de Nemes.
Pour comprendre comment le débat critique, idéologique et historique autant qu’esthétique, a pu en arriver à réconcilier des figures aussi opposées sur la question de la représentation de la Shoah que Didi-Huberman et Lanzmann (nul n’a encore écrit sur un éventuel rabibochage de Wajcman et Godard), il faut d’abord répondre à deux question plus simples.
#5
De quoi parle exactement Le Fils de Saul ? Le film ne parle pas de filiation, il tisse seulement une fiction dont on suit tant bien que mal le fil ténu jusqu’à le perdre par moments, tant le décorum emporte tout sur son passage. Néanmoins, la question du fils mérite qu’on s’y accroche. Elle constitue la seule question qui trouve dans le film une réponse. Enterrer un fils, fût-il hypothétique, c’est retrouver une dignité, sinon celle de l’enfant, en tout cas la sienne propre. Ce fil est la porte de sortie vers l’humanité que le film tient en permanence à se ménager. Comment ne pas oublier qu’on est humain dans une usine de la mort qui est aussi une machine à déshumaniser ? En reconnaissant à un enfant le droit d’être enterré, en voyant en lui, même si ce n’est pas vrai, un héritier, un fils. Cette idée n’est elle-même pas sans poser de problèmes. Il peut être en effet plaisant d’imaginer qu’un membre du Sonderkommando ait projeté de laisser, dans une terre dont les nazis et certains locaux avaient prévu d’exterminer les habitants juifs, la trace d’une présence indésirable. Le fait est néanmoins qu’aujourd’hui comme à l’époque du film, la tentative n’a rien que de symbolique et apparaît au fond dérisoire. Serait-ce là la seule chose que le film opposerait à l’ordre nazi ? La fiction est en tout cas réparatrice, elle permet de souffler un peu et de suivre autre chose que le pénible trajet réaliste que le film orchestre. Bref, elle invente un autre voyage, qui puisse non pas nous sortir du camp, mais qui produise d’autres images que la simple reconstruction d’Auschwitz. On peut, alors, s’interroger sur la position du film vis à vis de cette reconstitution.
#6
A quel moment du débat intellectuel intervient sa sortie ? Interpréter Le Fils de Saul revient en réalité à prendre au sérieux Sortir du noir et son idée de “conte documentaire”. Il faudrait en tirer une morale, quelques leçons, pourquoi pas une réflexion historique ou politique. Pour cela, il est nécessaire de dire à quel moment nous sommes de la réflexion collective sur la Shoah et sa représentation au cinéma. Deux types de discussions cohabitent : l’une est strictement critique, elle concerne une poignée de films (citons-les : La liste de Schindler de Steven Spielberg, La Vie est belle de Roberto Benigni) ; l’autre a été l’occasion d’un débat entre intellectuels, universitaires et artistes de renom, dont Georges Didi-Huberman, Jean-Luc Godard, Gérard Wajcman et Claude Lanzmann ont été les protagonistes. Celle-ci plaçait au centre de la controverse deux films, Histoire(s) du cinéma de Godard et Shoah de Lanzmann, mais aussi un livre, Images malgré tout de Didi-Huberman.
Un film pourtant important sur la Shoah est systématiquement oublié dans ces discussions : La Passagère, un film polonais de 1962 signé Andrzej Munk. Dans Images malgré tout, Didi-Huberman, qui se livre pourtant à de longs développements sur Histoire(s)..., dans lequel figurent des images du film de Munk, n’en dit mot. Lanzmann, qui pourrait simplement ne pas connaître le film, n’en serait pas à son premier coup : c’était déjà pour anti-polonisme que Yannick Haenel avait attaqué le cinéaste quand il faisait remarquer, au moment de la parution de son Jan Karski, que l’entretien avec l’envoyé du gouvernement polonais en exil avait été réduit à la portion congrue dans Shoah. Lanzmann avait répondu en sortant dans les mois qui ont suivi Le Rapport Karski, une version sensiblement plus longue du même entretien. Wajcman ne parle jamais du film de Munk. Seul Godard l’a remarqué, et le considère comme un “film d’expiation”.
#7
Le débat critique n’a jamais vraiment dépassé les frontières de la morale et des émotions acceptables. Sur La Liste de Schindler, on a beaucoup dit combien le scène de la douche et son suspense maladroit étaient, au moins, gênants. Sandrine Rinaldi avait bien tenté une défense du film dans les Cahiers du cinéma en disant que finalement, le film étant du côté de la vie (il fait l’inventaire de tout ce qui est encore vivant dans les usines de la mort), il faut également apprécier le fait que Spielberg aurait été réellement abject s’il avait terminé la scène de la chambre à gaz par la mort de ses occupants. L’argument, vingt ans après, demeure très faible, mais jamais autant que l’attaque de Lanzmann contre le film, qui pouvait se résumer au refus de tolérer des fictions sur la Shoah. La Vie est belle, avec son histoire fondée sur le mensonge d’un père à son fils (il fait passer l’expérience concentrationnaire pour un grand jeu), a été victime du même type de reproches : sentimentalisme, inconséquence, etc. Benigni ne savait clairement pas ce qu’il faisait. Il s’est réfugié derrière le regard de l’enfant en identifiant la fiction au mensonge. Ce n’est pas la manière la plus intelligente de contrer les inepties de Lanzmann.
Ce que Godard a décelé chez Spielberg et qui lui rendait le film réellement insupportable, tenait à des raisons plus simplement - mais aussi plus profondément - politiques et historiques. JLG est peut-être en effet le seul à avoir dit avec clarté ce qui posait problème dans La Liste de Schindler. Il l’énonce dans Histoire(s) du cinéma, tout de suite après avoir évoqué La Passagère : “Et puis, les Polonais ont invité Spielberg quand “plus jamais ça” est devenu “c’est toujours ça”. En bref, l’usine de mort a été recréée en machine industrielle. Spielberg a fait reconstruire Auschwitz sous le masque d’un studio de cinéma, en a fait un critère de vérité revendiqué d’un film “inspiré de faits réels”. Il reste frappant de voir que l’histoire de Schindler a été édulcorée quand le camp lui-même a connu les honneurs d’une fidélité plus grande… Aujourd’hui encore, Cracovie est fière d’exhiber ce qui reste des décors à des fins touristiques. Le capitalisme, lui aussi sous des formes édulcorées, bégaie quelque peu. Godard a bien vu dans l’idéologie mémorielle, qui s’accommode volontiers du règne du capital mais jette aux oubliettes les films de ceux qui tentent d’expier leurs fautes, le mécanisme qui permet non pas à l’histoire de faire le tri entre le bon grain et l’ivraie, mais de faire se répéter des événements parce qu’elle est, en réalité, l’empire de l’oubli.
Ce sont justement les tenants de cette idéologie qui pourraient dire que, dans l’affaire, ce que pointe Godard n’est qu’un détail. On pourrait dresser la liste des qualités négatives que trouvent au Fils de Saul ses laudateurs et les comparer avec les éléments de langage du discours négationniste. Puisque, finalement, nous ne serions pas à Auschwitz, est-ce bien la Shoah que nous avons sous les yeux ? On retrouve chez ceux qui soutiennent que le propos est universel certaines des postulations de ceux qui d’habitude nient l’évidence.
#8
Dans le film de Nemes, nous sommes à Birkenau, au plus fort de la politique d’extermination. Plusieurs commentateurs ont fait observer que Le Fils de Saul était en quelque sorte une adaptation d’Images malgré tout. En effet, il met en scène la prise d’une au moins des quatre photographies dont parle Didi-Huberman dans son livre. Les clichés sont l’oeuvre de membres du Sonderkommando d’Auschwitz. Dans le film, le coeur de la scène oppose un plan sur l’homme tenant l’appareil à un contrechamp reproduisant exactement le cadrage de la photographie. Plus qu’un hommage à son travail de chercheur, l’auteur de Sortir du noir voit dans cet enchaînement la matérialisation de la thèse de la première partie de son ouvrage. Le cliché réel, réaliste à l’extrême, nous plongeait dans l’horreur de la Shoah, il vient du fin fond de l’Enfer. En reprenant son esthétique mais en l’insérant dans une fiction, Nemes lui ajoute une fonction libératrice. Aussitôt entré dans l’horreur, aussitôt sorti du noir. D’ailleurs, Didi-Huberman n’écrit-il pas que le champ contrechamp est fondamental dans cette opération que décrit le titre du livre, puisque le photographe serait dans la pénombre quand le plan suivant ouvrirait sur la lumière ? Heureuse simultanéité, c’est en nous décrivant l’horreur que Nemes permettrait de nous en délivrer. On pourrait examiner sérieusement cette proposition si elle n’était illustrée, dans le livre, par des photogrammes du film dont l’impression laisse franchement à désirer, et qui font effectivement croire, parce que beaucoup trop sombres, que Le Fils de Saul orchestre nettement ce passage des ténèbres à la lumière. Si les photogrammes choisis par GDH pour Sortir du noir devaient livrer un remontage du film, alors on n’en verrait rien : au mieux, en effet, leur valeur d’exemple est la même que celle des dessins dans un conte pour enfants dont l’édition aurait été bâclée. En réalité, cette scène a valeur de témoignage : Nemes ne transforme jamais ce qu’il filme, c’est pourquoi il est d’ailleurs proprement impossible d’imaginer que son oeuvre réfléchisse à autre chose qu’à la Shoah. Mais le cinéaste n’a pas la bêtise d’en faire un critère du vrai, comme Spielberg l’avait fait avec son camp dans Schindler. Il sait sans doute trop bien quelle a été la teneur du débat autour de la publication des quatre photographies prises par le Sonderkommando d’Auschwitz.
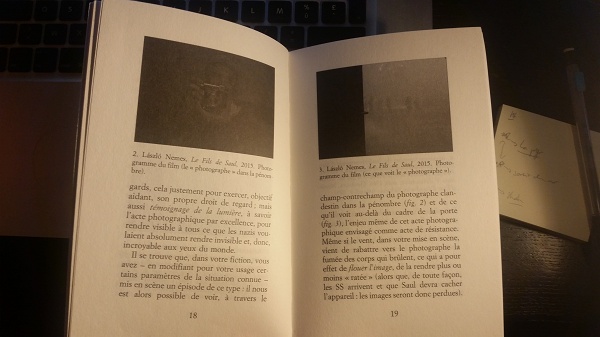
#9
Lanzmann a toujours dit qu’il n’y avait pas d’images de la Shoah, mais surtout que, quand bien même il y en aurait, il ne faudrait en aucun cas les publier. Cette iconophobie du cinéaste était opposée, dans un célèbre texte de Gérard Wajcman intitulé “Saint Paul Godard contre Moïse Lanzmann”, à une affirmation de Jean-Luc Godard. Godard avait en effet affirmé qu’avec “un bon journaliste”, il trouverait des images, “parce que les nazis enregistraient tout”. Tout l’inverse, sur le plan des principes, de la position de Lanzmann. En vertu, pour faire court, d’un respect de l’iconoclasme de la religion juive, Wajcman s’oppose à la “christianisation” de l’image. Christianisation à laquelle se livrerait ainsi Didi-Huberman en publiant Images malgré tout. Comme le montre l’historien de l’art, non seulement on peut toujours s’imaginer la Shoah, donc en produire des images, mais celles-ci existent réellement. Le film de Laszlo Nemes en imagine la genèse, ou plutôt le contrechamp.
#10
Le débat en avait donc a priori fini avec la critique de la dictature de l’émotion, du recours à la fiction et de la reconstitution des camps. La querelle universitaire avait réglé, semble-t-il, le problème du rapport des images à la Shoah. Comment expliquer, alors, que la critique de cinéma ait, à quelques exceptions près (dont Les Cahiers, pas franchement habiles sur le coup, quand ils ont rapproché le film d’un épisode de télé-réalité), tout oublié de ses anciennes préventions ? Comment Laszlo Nemes a-t-il réconcilié Lanzmann et Didi-Huberman ? Il faut reconnaître au Fils de Saul, à ce moment de la discussion, une vraie qualité : il s’engouffre systématiquement dans des brèches, explore les failles laissées béantes du débat critique ou universitaire. Parfois même, on l’a dit, il se permet de combler celles de l’histoire, trouve toujours réponse à tout, condense en deux jours des événements distants de plusieurs mois.
La première idée du film de Nemes consiste à créer un espace muséal. Le premier plan du film est entièrement flou, jusqu’à ce que la venue de Saul à l’avant-plan délimite une zone de netteté qui épouse les contours de sa figure. Saul, tout au long du film, sera notre guide. Le camp, chez Nemes, est néanmoins un musée d’un genre particulier ; ce n’est pas une simple évocation d’Auschwitz. Quelques repères historiques élémentaires laissent deviner au spectateur de quel lieu il s’agit. Quant au flou, rien n’y fait : on voit quand même. Il est difficile de discuter ce choix, qui apparaît finalement comme la simple résolution technique du problème que posait le parti pris de la mise en scène : filer Saul à la trace, de dos. De fait, il est tout aussi compliqué de dire qu’il s’agit là de pudeur sans faire à Nemes un procès en hypocrisie. Le fond des plans est flou comme si c’était un myope qui regardait, et après tout une interprétation simple pourrait suffire : puisque l’effet recherché est en partie une forme d’immersion du spectateur et d’actualisation des événements racontés, on peut imaginer que nous sommes un déporté qui aurait perdu ses lunettes. Cette idée paraît à la fois triviale et obscène, mais elle est aussi utile et fonctionnelle.
Un musée, d’ordinaire, modifie les contours de son objet. Sauf à prendre la place même de ce dont il veut parler. Si l’on se rend aujourd’hui à Auschwitz, on est dans ce dernier cas de figure. L’ancien camp est devenu un musée, payant pour ceux qui veulent un guide, gratuit pour les autres. Le parallèle avec le film peut être fait aisément. Pour la visite guidée, c’est Le Fils de Saul qu’il faut voir. Pour le reste, ce sera notre fameux film oublié et néanmoins bien connu : La Passagère d’Andrzej Munk.
#11
En deux endroits, le film de Nemes évoque celui de Spielberg, mais, comme nous ne sommes pas ici dans l’entertainment hollywoodien, ce qui jadis était une série de fautes morales devient ici une somme de simples choix esthético-économiques sans conséquence. La première fois quand, au bout de dix minutes, une scène nous montre des déportés se diriger, guidés par le Sonderkommando, vers une chambre à gaz : la porte se referme sur eux, et seuls leurs cris nous parviennent, mais ils sont suffisants, si l’on se fie à l’hypothèse de Didi-Huberman, pour nous imaginer ce qui se déroule derrière les murs. Quelques instants plus tard, les portes s’ouvrent, le film pénètre dans la chambre avec Saul, et les membres du Sonderkommando ramassent les corps. Ces corps sont flous ; on ne les voit certes pas en entier mais il n’y a aucun doute : ce que nous pouvons observer est le résultat de ce qu’il s’est passé juste avant. A l’inverse de ce qu’il se passait dans La Liste de Schindler, le gazage ne fait pas l’objet d’un scandaleux suspense. La vérité est crue, mais pas nue : on n’aura pas vu, nous dira-t-on, mais seulement entendu. Ce hors-champ est cependant quelque peu hypocrite : si les portes se ferment, c’est par une décence affichée de manière ostentatoire. Dans la mesure où, dans un film, le son fait aussi partie de l’image, les cris appellent ce que nous verrons plus tard dans le film, à l’occasion d’une scène elle aussi tirée d’une des photos prises par le Sonderkommando : des humains jetés dans une fosse aux morts, cette fois-ci à peu près nets. Cette pudeur aurait-elle été ce qui manquait à Spielberg ? Sans doute ce voile moral a-t-il satisfait les anciens procureurs, en plus de l’absence d’appel aux émotions du spectateur, tiraillé chez l’Américain par l’incertitude feinte dans le montage spielbergien. Ici, l’issue est claire.
Si ce à quoi nous avons affaire l’est aussi, il faut revenir sur le deuxième parallèle avec La Liste. Nemes, pas moins que Spielberg, reconstruit Auschwitz pour les besoins du tournage. Aux propres dires du cinéaste, cette reconstruction, combinée au parti pris immersif de la mise en scène, doit contribuer à une actualisation de l’expérience d’Auschwitz. Une exposition, dans un musée, a d’habitude pour fonction de mettre de la distance critique entre le public et les événements. Mais rappelons-nous que Le Fils de Saul, comme le musée qu’est devenu l’ancien camp, est une institution d’un genre particulier : si le film ne dit pas que nous sommes à Auschwitz, si certains peuvent se permettre de dire qu’on ne voit finalement pas grand-chose sinon rien aux corps sans vie ou à la machine exterminatrice, c’est qu’il faut en réalité détourner le regard pour ne se concentrer que sur l’aspect symbolique de la fable. Autrement dit, dans “conte documentaire”, il faut d’abord entendre “conte” et ensuite “documentaire”. Le symbole (à Auschwitz aujourd’hui, un tas de vêtements pour des victimes ; dans le film, des morceaux de corps et de camp pour la totalité d’une expérience-limite) est premier, la caution réaliste suit. “C’est toujours ça”, disait Godard, et Le Fils de Saul ne propose hélas rien d’autre. Qui peut soutenir décemment qu’il faudrait remettre Auschwitz au goût du jour, quelle nécessité politique l’exige ? La force évocatrice de l’expérience concentrationnaire passe par les symboles, nous dit Nemes, mais apparemment, ces symboles ne se passent pas d’une reconstitution qui doit faire sentir l’impérieuse nécessité de nous rendre Auschwitz présent.
#12
Auschwitz pourrait être de nouveau notre avenir, et s’il est notre présent, il aurait fallu que le film le montre, au-delà des injonctions réalistes et pour tout dire franchement vulgaires, tant elles revendiquent l’immédiateté d’une expérience dont le récit n’a jusque là pas pu se passer d’une médiation critique. Didi-Huberman lui-même n’avait pas supporté la vulgarité du camp-musée tel qu’on peut le visiter aujourd’hui, lorsqu’il a publié Ecorces, qu’il faut lire comme le premier tome d’un diptyque dont Sortir du noir serait le second volume. L’ouvrage consistait à faire le récit de la première et dernière visite de l’auteur dans ce lieu désormais dit “de mémoire”. De fait, Didi-Huberman n’y a pas vu grand-chose sinon l’infinie bêtise politique qui en ressort et l’abrutissement qu’il exerce sur ses visiteurs. ll n’en a d’ailleurs ramené, comme traces matérielles, que des écorces de bouleaux des bois entourant le camp qui ont donné leur titre au livre. Ces écorces évoquaient à l’auteur des caractères hébraïques.
Nemes accomplit une opération doublement contradictoire si l’on s’en tient à la lecture d’Ecorces comme prélude à Sortir du noir. Il rend d’abord présent Auschwitz en le reconstruisant comme le musée tente de nous introduire à la réalité des camps. Il suggère ensuite à la fois qu’il n’y a que du flou à y voir et que ce flou représente malgré tout quelque chose, ce quelque chose qu’aujourd’hui nous pouvons percevoir de l’expérience passée.
Didi-Huberman lui-même a parsemé toute son oeuvre de réflexions critiques sur l’institution même du musée. Le fait qu’elle ne permette pas de mettre une pensée en mouvement, qu’elle intègre difficilement l’idée de montage, si importante chez lui pour la progression intellectuelle, l’amenait à s’en méfier. Qu’il n’ait pas vu dans Le Fils de Saul ce qu’il dénonçait justement ailleurs est incompréhensible. Le musée, en effet, n’autorise nulle manipulation, et Le Fils de Saul est un film qu’on ne peut monter avec aucun autre, sinon par stricte identité formelle (avec Requiem pour un massacre d’Elem Klimov, sa principale source d’inspiration cinématographique). C’est un film avec lequel on n’oserait pas jouer parce qu’il crie son unicité à chaque plan. Le musée assigne aussi une place en même temps qu’il fige, établit une distance qui ne change jamais : quelque part, il annihile le débat critique. Peut-être est-ce seulement pour cela qu’aujourd’hui Didi-Huberman est d’accord avec Lanzmann.

#13
Aucun film n’est plus éloigné du Fils de Saul que La Passagère. Pourtant, les deux se déroulent dans un camp, durant la seconde guerre mondiale. Il est vrai que le film polonais met en place un dispositif narratif qui intègre de la distance et de l’hétérogénéité dans le récit. La Passagère met en scène deux récits, l’un emboîté dans l’autre. Dans les années 1950, un couple quitte l’Europe pour le Brésil à bord d’un paquebot. Un jour, la femme raconte à son mari un épisode de sa vie avant le mariage. Elle lui avoue avoir été gardienne SS dans un camp de concentration et raconte une idylle entre deux déportés, qu’elle aurait favorisée. Néanmoins, rongée par le remords et la culpabilité, la femme revient sur son premier récit, et en fait un second, dans lequel elle raconte les humiliations et mauvais traitements qu’elle a fait subir à la fille du camp qui tentait de vivre son histoire d’amour. Le réalisateur Andrzej Munk revisite donc un des motifs les plus célèbres de la narration cinématographique, le faux flash-back, dont on connaît la désaffection dont il a fait l’objet, notamment en raison de son utilisation maladroite dans Le Grand Alibi d’Alfred Hitchcock, que le cinéaste a lui-même reniée. Munk est par ailleurs un spécialiste des faux flash-backs : Un homme sur la voie est entièrement construit autour de ce motif. Néanmoins, on ne peut pas dire que le sujet, ou l’un des sujets de La Passagère n’est pas l’expérience concentrationnaire. L’héroïne du film est une allemande et le couple de déportés est polonais. Cela jette une lumière singulière sur l’idée de fiction réparatrice qu’a invoquée Godard en parlant de “film d’expiation” : les Polonais y sont donc des victimes, d’abord secourues, puis enfoncées. L’Allemande est en revanche d’abord, selon la chronologie réelle, une rebelle discrète, puis une nazie zélée, avant de se montrer en menteuse déshonorée et de finir en paradoxale victime expiatoire. C’est elle qui expie ses péchés en s’avouant menteuse, mais le film d’un Polonais l’utilise aussi comme manière indirecte d’expier les péchés inavouables d’une Pologne qui se vit en victime éternelle. Le récit réagence ces “moments moraux” : d’abord, il y a le mensonge et le déshonneur ; puis la rébellion fantasmée ; ensuite, l’expiation ; enfin, le zèle de l’horreur. On remarque alors que sont associés au mensonge et le déshonneur et la rébellion ; à la vérité, le nazisme dans sa crudité cruelle et l’expiation. Dans les deux cas, un visage de l’Allemagne (nazisme, déshonneur) et un de la Pologne (rébellion, expiation).
Ce film admirablement composé montre que le mensonge n’est jamais anodin, et qu’il ne fait que masquer une alliance des contraires. Il expose rigoureusement cette alliance problématique, et n’entend ni la résoudre ni la justifier. Le film de Nemes, en revanche, homogénéise tout par des renversements successifs. Saul n’a pas de fils, mais son honneur est sauf ; son humanité même passe par le fait de mentir. On pourrait y voir une belle idée, si le paradoxe ne butait pas à son tour sur la vérité historique, elle du côté de la rébellion, de la prise des clichés et de l’insurrection. La Passagère associait la culpabilisation et l’expiation en en croisant les représentants, en ne cessant de rechercher l’impureté. L’image de l’honneur, son symbole, suffisent au Fils de Saul : ce ne sont que des cautions. Si le film relègue dans le flou la barbarie mais ne la rend pas moins visible, c’est parce que c’est plutôt la rébellion, la révolte et l’honneur qui sont relégués par le film. Didi-Huberman ne s’y est pas trompé, il l’écrit lui-même : la vraie résistance, c’est d’enterrer un enfant, pas de prendre part à l’insurrection. Saul n’est pas impur, il se rebelle totalement, mais à sa manière : c’est après tout le gardien du musée, celui qui (nous) reste. Ce goût de Nemes pour le renversement finit aussi par révulser : nous pouvons, aussi, retourner la fin du film.
#14
La dernière séquence du Fils de Saul raconte l’évasion ratée du camp de certains membres du Sonderkommando après l’insurrection. Elle intervient après que Saul a perdu le corps de son “fils” dans une rivière qui longe le camp. Au-delà de la reconquête de l’humanité perdue, il pourrait s’agir, on l’a déjà dit, de laisser la trace d’une présence juive dans une terre qui en sera bientôt entièrement dépourvue. Le fils - et par là même le fil de la fiction - perdu, la séquence finale doit en inventer une image. Les quelques membres du Sonderkommando trouvent refuge dans une cabane forestière, se croyant peut-être sauvés alors que les nazis sont à leurs trousses et ne vont pas tarder à les retrouver puis à les exécuter froidement, hors-champ. Peu avant l’exécution, un petit garçon repère la cabane dans les bois, s’en approche et regarde à l’intérieur. Seul Saul le regarde, et à la vue de l’enfant, un sourire illumine son visage pour la première et la dernière fois. Puis, le garçon s’en va, avant que nous ne nous apercevions qu’il a, sans doute involontairement (puisqu’un homme lui plaque la main sur la bouche), guidé les nazis vers l’abri. Enfin, il continue son chemin en gambadant dans une clairière.
Faisons l’hypothèse que pour Saul, et pas seulement pour lui, ce jeune garçon est une image possible de l’enfant perdu, le symbole de la réussite, finalement, de l’entreprise du héros, quelque chose qui apparaît comme une rédemption. Bien sûr, cet enfant est différent de celui que Saul a cherché à enterrer. Il n’est pas brun et famélique, mais rond et blond. On peut sans trop prendre de risques dire que c’est un petit Polonais, catholique, qui peut se permettre une promenade dans les bois. Il aura eu 27 ans à la sortie de La Passagère, 54 à la chute du communisme, il en a 80 aujourd’hui, presque l’âge de JLG. Il a 15 ans de moins que les héros de Munk. Que dire alors de ce transfert ? On ne peut de nouveau formuler que des hypothèses. L’enfant brun ne trouvera pas de sépulture non loin d’un haut lieu de l’extermination antisémite. L’enfant blond aura peut-être été élevé dans l’antisémitisme populaire polonais : une des thèses de Shoah de Lanzmann est d’ailleurs, d’après Slavoj Zizek qui la conteste, que la judéophobie polonaise est l’une des causes principales de l’extermination des juifs d’Europe. L’histoire est alors appelée à recommencer, et Le Fils de Saul incarne ce recommencement. Pas marxiste pour un sou, Nemes rejoue la tragédie au présent. Pour cela, il fond l’image du fils de bourreaux (imaginons ici que les parents de l’enfant blond sont de ceux qui ont vu d’un bon oeil l’extermination) avec celle de la victime. Là encore, le film vise l’homogénéité formelle, le choc immédiat. La Pologne est un pays qui a simplement oublié son passé juif. Le pays que nous connaissons aujourd’hui est neuf. Nul - ou presque - d’ailleurs ne l’imagine, en Pologne, tel qu’il était. Pourtant, ce n’est pas impossible, tout comme il n’est pas impossible d’imaginer la Shoah. Où est le vide, alors ? Dans la logique : on échoue à enterrer l’enfant juif, on récolte l’antisémitisme catholique. Au revival d’Auschwitz, la tragédie des Juifs, s’oppose l’image du petit chrétien. Mais elle s’y superpose aussi, le plus grand échec devenant la plus grande réussite, et inversement. L’image renversée est le parfait motif de réconciliation entre Lanzmann l’iconophobe et Didi-Huberman l’ami des images.
#15
Didi-Huberman a écrit de nombreuses pages sur Shoah, un film qu’il aime beaucoup. Ce qui manque aujourd’hui comme hier, c’est le regard critique d’un historien de l’art jadis porté sur le débat et la discussion plutôt que sur la louange, et qui renoue dans Sortir du noir avec le registre laudatif qu’il avait adopté pour parler du film de Lanzmann. Ce registre, où la perspective peut se renverser mais jamais se déplacer, est celui réservé dès lors qu’il s’agit d’évoquer le chef d’oeuvre indépassable du moment.


