LES TROIS JOURS DU CERBERE

Jour 1. Acoustique de l’Overlook Hotel
Soleils de Printemps, de Stefan Ivancic (2013, 23’)
Tzvetanka, de Youlian Tabakov (2012, 66’)
La leçon sibérienne, de Wojciech Staron (1998, 58’)
La première chose que l’on remarque à Cerbère, et la première chose dont on ait envie de parler, c’est l’acoustique de la salle. Mais il faut se retenir un peu et présenter d’abord ces rencontres : car « Cerbère se mérite », comme le vantent les brochures touristiques. Se mérite parce que c’est un peu loin, que la route sinue longtemps avant de parvenir à cet arc de maisons posées les unes sur les autres dans une crique, à quatre kilomètres de la frontière espagnole, sur la Méditerranée. Il y a bien quelque chose du hasard extraordinaire au fait de venir chercher là images et films, hors de toute actualité – puisqu’il s’agit surtout de cartes blanches à des programmateurs (Jean-Pierre Rehm du FID, Jacky Evrard de Côté Court, Oskar Alegria de Punto de Vista, Arnaud Hée du Réel...). Une fois le projecteur mis en place (délice des réglages effectués à même le grand écran, du drôle de bruit que fait l’iMac quand on augmente le volume), ces images rencontrées font à leur tour la rencontre de quelque chose qui les transcende – l’acoustique, oui. Car cette salle unique, c’est celle du Belvédère, posé sur une falaise, hôtel en forme de fer à repasser ou de coque de bateau. Il est bâti au bord des voies ferrées qui lui filent aux pieds, une cinquantaine de mètres en contrebas. Aujourd’hui la peinture s’en est allée, le bâtiment perd son crépi, sauf à la proue, repeinte en blanc de fraîche date. La salle de projection, elle, n’a pas changé, sorte de théâtre à l’italienne au plafond immaculé, assez haut. Aux murs de la salle de réception, dessins décatis, jaune écorché de blanc, on dirait Pompéi. Un peu Shining aussi, et ses fantômes. A raison : la salle de cinéma, les sièges sur lesquels nous sommes assis, sont d’époque, et l’époque, c’est 1928 – soit celle des fantômes du film de Kubrick. Mieux : le cinéma n’a été ouvert que pendant quatre ans. Que s’est-il passé en 1932 ? Patrick Viret, l’organisateur – ou devrait-on dire : le fédérateur – de ces rencontres part soudain s’occuper de réglages. On n’en saura pas plus.
Et l’acoustique ?
C’est d’abord celle d’un dialogue entre les films et le décor, par exemple entre ceux qui, pour le premier jour du moins, auront de près ou de loin parlé trains, filmé trains (départs symboliques, plans inauguraux sur les voies…). Or pendant ce temps la salle tremble un peu : les convois passent, partent pour l’Espagne, cinquante mètres plus bas. Le réel répond aux films, ces deux-là communiquent. La faible épaisseur du toit laisse nettement entendre les oiseaux qui s’y posent, et piaillent : la véritable rencontre de Cerbère, c’est celle-là, celle de ces images fortuites – puisque laissées à la décision non pas d’un programmateur mais de plusieurs invités – et de cette vieille dame, accueillante épave, tremblante et toute démaquillée, en villégiature. Nul programme à défricher pour choisir ses séances : la star, c’est vraiment la salle, unique en son genre. On se laisse donc guider, on suit les rails, de rencontre en rencontre, toujours du troisième type. Les films sont là, occupent l’espace, emplissent la salle, y résonnent fort.
Du coup, parler des films, c’est déjà s’éloigner de l’essence de ces rencontres. Quand même : la première séance est une carte blanche à Tess Renaudo, du festival L’Alternativa de Barcelone. Images de Serbie, puis de Bulgarie. D’abord une jeunesse désœuvrée (Soleils de printemps), la même en Serbie qu’ailleurs, filmée improvisante en plan-séquence. Film d’enfants perdus, très indolent (guettez l’apparition de l’adjectif « in-Dolan », bientôt, bientôt). C’est ensuite un long-métrage, Tzvetanka, spectaculaire biographie d’une femme Bulgare ayant traversé le XXe siècle. Il s’écoute comme un conte – d’ailleurs quelques effets numériques, des plans aériens et une poignée de saillies humoristiques gentiment surréalisantes viennent rompre la monotonie qui guettait l’exercice en flirtant avec le merveilleux. La découverte de la première soirée reste La leçon sibérienne, de Wojciech Staron, documentaire sur sa femme d’un homme qui la suit au fin fond de la Sibérie, où elle part enseigner le Polonais, et où les gens s’ennuient mortellement dans les ruines du léninisme, s’occupant comme ils peuvent (en immolant des porcs, en faisant semblant d’en vendre la tête parce que le commerce ne ramène de toutes façons plus rien). Soit la rencontre fortuite, en pays catalan, des habitants du fin fond de la Sibérie à la fin des années 90 et d’une cinquantaine de spectateurs de 2014. Ce qui reste, cependant, est l’histoire de futurs mariés – le film documente d’abord une rencontre, encore et toujours, celle de deux fiancés. Amusant de voir leur fille d’une dizaine d’année dans la salle, et de regarder le film comme une sorte d’archéologie de la petite…

Jour 2. Le silence des oiseaux
Petersbourg, notes sur la mélodie des choses, de Charlie Rojo (2014, 110’)
Léone, mère et fils, de Lucile Chaufour (2014, 41’)
Je suis, de Myriam Ayçaguer (2013, 46’)
El Otro Dia, d’Ignacio Aguero (2012, 120’)
In Ictu Oculi, de Greta Alfaro (2009, 11’)
La leçon argentine, de Wojciech Staron (2011, 59’)
Les éternuements et raclements de gorge du public résonnent dans la salle comme les sons qui sortent des haut-parleurs, subissent la même métamorphose sonore. Un personnage, dans un film, appelle : je regarde ma voisine : impossible de savoir si l’appel vient de l’extérieur du cinéma (le haut des murs est percé) ou du film. Quelqu’un appelle, mais où est-il ? Les images, elles aussi, se répondent. Les murs décrépis à l’écran répondent à ceux qui l’environnent, et les trains continuent de passer à l’image comme sur les voies d’à côté. On est cette fois à Saint Pétersbourg et le film de Charlie Rojo, Petersbourg, notes sur la mélodie des choses, confirme la tendance « acousticiste » du festival : filmer Saint Pétersbourg, c’est enregistrer la mélodie des bruits, filmer en écoutant plutôt qu’en regardant. L’écho poursuit ses merveilles, cette fois lorsqu’une pelle racle longuement une tombe pour en ôter la neige, dans un cimetière de chevaux. La visite de Pétersbourg par Rojo lui permet surtout de suivre un visage, celui d’une jeune femme russe à l’accent merveilleux. Encore une fois, on écoute le son et l’écho de sa voix plus que ce qu’elle nous dit.
Les rencontres de Cerbère sont certes celles du cinéma et du réel mais aussi celles du documentaire et de la fiction. La majorité des films choisis par les partenaires de Patrick Viret nagent entre deux eaux – le programme se garde bien de préciser, comme au Festival de Brive par exemple, à quel genre d’images on a affaire. Et l’on hésite longtemps. Cet enfant et cette mère, fous d’amour l’un pour l’autre, dans le magnifique Léone, mère et fils de Lucile Chaufour, jouent-ils la comédie comme dans un film, disons, de Jean-Charles Hue ? Ou pas du tout ? Le noir et blanc, ici, contribue à brouiller les pistes, de même que le décrochage temporel à la Richard Linklater qui s’effectue soudain, en pleine phase de jeu dans la chambre, entre l’enfance du gosse et son adolescence, six ou sept bonnes années plus tard. On ressort de la chambre : le père, lui, n’a pas pris une ride… Dans le Voyage d’Ana, de Pamela Varela, la jeune bourgeoise française qui rencontre des pauvres chiliens est-elle l’actrice, ou le personnage ? Les Chiliens sont-ils réels ou sortent-ils d’une imagination de poète ? Mais l’effet est ici voulu, or l’hésitation est meilleure lorsqu’elle n’est pas revendiquée par l’histoire, et se contente de n’être qu’une conséquence de celle-ci. Dans la suite de La Leçon Sibérienne, La Leçon Argentine, tourné dix ans plus tard, Wojciech Staron cherche ainsi trop à appliquer, sinon la leçon, la recette du premier épisode, qui consistait justement à se servir de son quotidien pour nourrir un film qui ressemblerait à une romance. Résultat, les souffrances de ses voisins en larmes, filmées sous plusieurs angles, évoquent plus la téléréalité qu’autre chose.
C’est enfin l’heure du film sans images, Je suis, de Myriam Ayçaguer, film par excellence de ces rencontres puisqu’entièrement sonore. Un écran noir est projeté sur la toile, où s’affichent les sous-titres. Le son, lui, est rigoureusement celui d’un documentaire réalisé par quelqu’un sur sa famille, genre si connu qu’on en vient à avoir précisément, en tête, les images, et qu’on finit par se demander si les images n’a pas été tournées, montées, puis simplement cachées. Il n’en est rien : Je suis est l’illusion d’un film, entièrement conçu à partir de micros, sans aucune caméra. Parfois cependant, la superposition de la voix de la grand-mère et de celle de la narratrice donne la certitude que la première est in et que l’autre est off – joli paradoxe, puisqu’il n’y a rien à l’image. On en viendrait presque à parler de Je suis comme n’importe quel autre documentaire : que veut dire cette scène où les personnages disent ça, pourquoi filme-t-on dans cette pièce et pas dans une autre, pourquoi avoir coupé à cet endroit et pas à cet autre ? Ayçaguer met à l’épreuve la perception qu’on se fait de ce genre de documentaire, de la place de l’image : si l’on peut critiquer le film comme un autre, alors à quoi auraient servi les images ? Et si l’absence de celles-ci n’avait servi qu’à signifier le fait que la grand-mère et la maison, en pays basque où est tourné le film, sont une seule et même entité, comme l’explique la réalisatrice ? Et si l’absence d’images servait simplement à ne pas donner la primauté à l’image du bâtiment sur celui de l’humain ? Alors, on pourrait analyser Je suis comme n’importe quel autre documentaire, images visibles ou non. Et on aurait l’air fin…

Le réel passe saluer le film lorsque les portes s’ouvrent : des rais de lumières glissent alors sur l’écran noir qui leur fait face, comme la lumière des phares sur la mer, pendant la nuit précédente. Projeté juste après,El Otro Dia d’Ignacio Aguero consacre lui aussi beaucoup de temps aux mouvements de la lumière sur les images. C’est même le point de départ de son film : un plan fixe sur une vieille photo en noir et blanc, tandis que des cercles de jour, dans l’ombre de la maison, glissent dessus à vitesse réelle. Cette photo, évidemment, est celle d’une rencontre… Et tout le film de ne parler que de cela, de rencontres, que ce soit celles d’une lumière et d’une photo, d’une lumière et d’un écran ou d’un inconnu avec le réalisateur, qui décide de filmer les gens qui frappent à sa porte, et d’aller leur rendre visite chez eux. La scène est au Chili, à Santiago. Le réalisateur filme de sa fenêtre des animaux programmatiques : chat à l’affût de coïncidences, oiseaux allant et venant dans le champ de la caméra à leur guise, laissant la caméra espérer que le hasard lui redonnera quelques plumes à se mettre sous la dent. Ces coïncidences, bien sûr, proviennent aussi bien de ses visiteurs que du contact entre le film et la salle du Belvédère. Lorsqu’Ignacio filme le soleil qui éclaire la photo de ses parents, c’est le reflet du projecteur numérique que l’on regarde, lui aussi la source d’anciennes images. Quant aux oiseaux, impossible de savoir s’ils font partie de la bande-son ou non : cela pourrait être ceux qui se perchent sur le toit du Belvédère. Inconsciemment, le spectateur peut se dire que s’il entend des oiseaux, c’est parce que la salle n’est pas insonorisée, et qu’il n’y a pas un seul oiseau à Santiago. El Otro Dia y gagne une sécheresse qui le détache des documentaires habituels. Sécheresse toute suggérée par le lieu de la projection, rien d’autre.
C’est samedi soir : on traverse la frontière espagnole, au sommet d’une crête, et l’on rejoint Portbou, crique symétrique à Cerbère, de l’autre côté du relief. L’écran est en plein air, au bord des vagues. A l’écran, toujours des oiseaux : dans In ictu Oculi, de Greta Alfaro, des vautours envahissent, en un seul plan fixe de onze minutes, une table montée dans la campagne comme pour un dîner mondain. Tout se casse la figure tandis que la meute des volatiles se rue sur les morceaux de viande disséminés sur la nappe, écartent sublimement leurs ailes, se chamaillent, fuient le plan, prennent la pose, se répondent géométriquement – et par hasard, toujours. L’acoustique continue ses miracles : on entend plus les vagues sur les galets que les bruits de mastication. Cerbère est un festival sonore, c’est aussi celui de la mise en scène des projections de films, de la redécouverte sensuelle de ceux-ci, en dehors des salles habituelles – c’est peut-être le sens de cette deuxième vie qui leur est offerte par les programmateurs invités : sortir les films du cadre des festivals, les sortir, littéralement, du cadre architectural qui les attend généralement (fauteuils rouges, moquette aux murs…).
Jour 3. La parole en short
J’ai mis neuf ans à ne pas terminer, de Frédéric Danos (2010, 75’)
Etre vivant, d’Emmanuel Gras (2014, 17’)
Iranien, de Mehran Tamadon (2014, 105’)
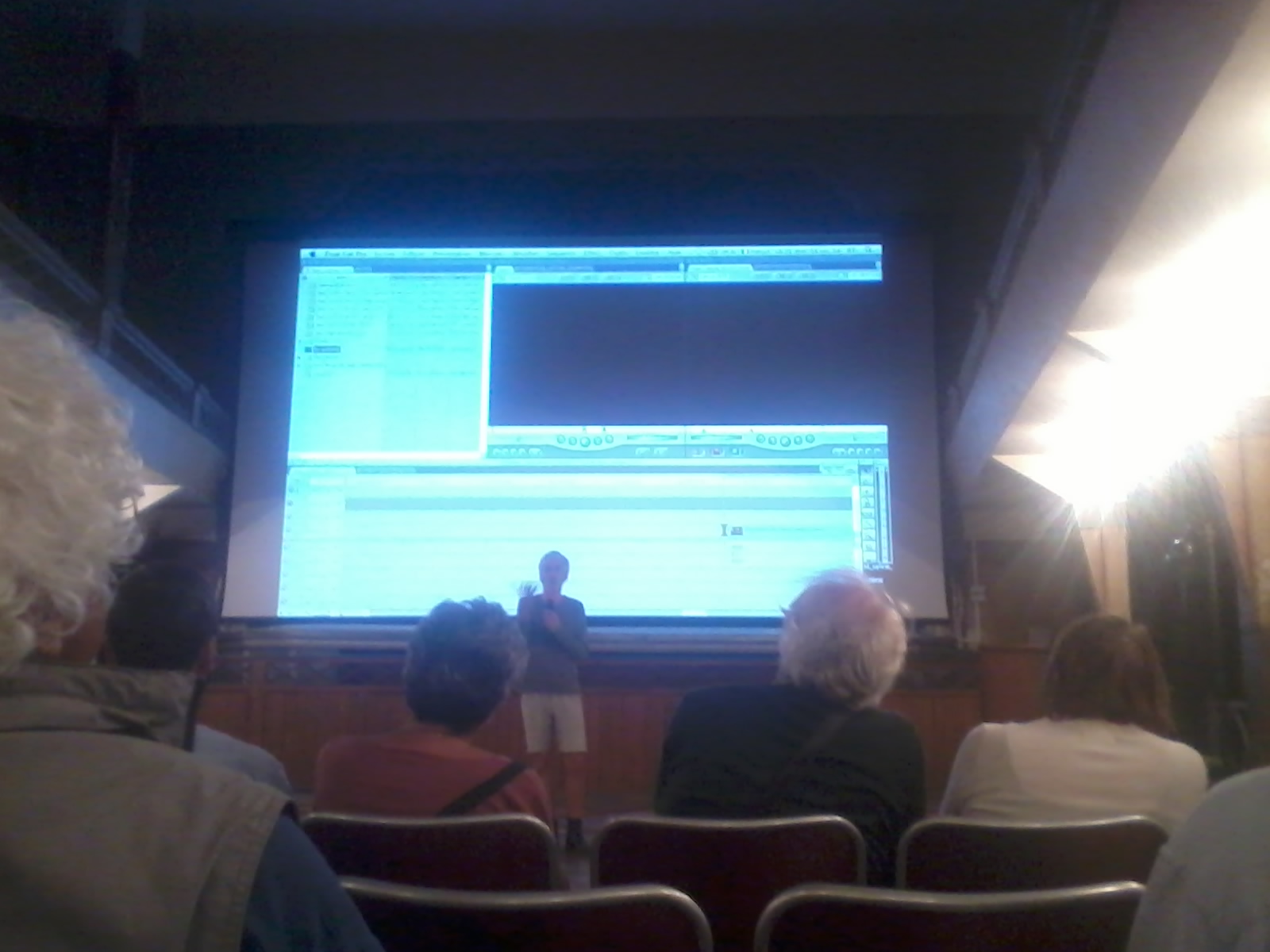
Nouvelle séance emblématique du festival, alors : J’ai mis neuf ans à ne pas terminer, de Frédéric Danos. A la lecture du programme, on s’attend à une sorte de Lost in La Mancha du pauvre sur l’impossibilité d’un réalisateur à boucler son projet. Voici donc Frédéric Danos devant l’écran, en short, micro en main, qui évoque son documentaire sur des ouvriers en grève : « je voulais faire un truc politique »… Il lance les rushes, qui s’interrompent : le revoilà, avec son micro et son baratin. Une autre série de rushes débute, sur un autre sujet, s’interrompt de nouveau – nouvelle intervention, puis nouveau sujet, et ainsi de suite. Plutôt futé dans sa manière de transposer le méta-dispositif digressif de Si par une nuit d’hiver un voyageur d’Italo Calvino, le film – ou plutôt la performance – souffre bel et bien de ce dont il dit souffrir, c’est-à-dire son absence de sujet. Au moins la mise en abyme est parfaite… « Qui suis-je », la question revient souvent ; pas de réponse, évidemment : le film ne parle de rien, et reste l’ébauche d’une forme ludique de cinéma à venir, où dialoguent la salle et les images. On pense également à Francis Ford Coppola qui voulait monter Twixt en direct, aux performances de video-jockeying d’Olivier Séror sur Panexlab, ou encore à Marc Caro qui, au même moment, au festival War On Screen de Châlons-en-Champagne, remixait Le bunker de la dernière rafale, tourné avec Jeunet en 81. Si un lieu peut permettre à cette forme de ciné-performance de s’épanouir (et de finir par dire quelque chose) c’est le Belvédère. Côté Calvino, mentionnons le court-métrage d’Emmanuel Gras, Être vivant, trip à la Jan Kounen sur le devenir-SDF entièrement tourné en travelling arrière, ce qui donne un peu l’impression d’un tour en nacelle montée sur des rails à l’intérieur d’un Manoir Hanté. Calvino pourtant, parce que le film cligne de l’œil à un autre maître oulipien, Georges Pérec : le premier plan du film est celui d’un HLM semblable à celui des La Vie mode d’emploi, quant à la voix off, elle est écrite à la deuxième personne du singulier, comme le texte d’Un homme qui dort. Toute coïncidence étant bien entendue fortuite, puisque le texte lu se fonde sur une lettre anonyme reçue par une association…
Ce troisième jour est surtout celui de la projection d’Iranien, de Mehran Tamadon. Découvert en février dans la section Panorama du Festival de Berlin, revu au Cinéma du Réel, Iranien, comme le Banyuls qu’il rapportera à son réalisateur, se bonifie avec le temps. Tamadon, Iranien vivant en France, invite donc quatre religieux à le rejoindre dans une villa pour discuter de la possibilité d’un état laïc en Iran. Et ce n’est plus seulement le film d’action semi-tarantinien, que j’encensais à Berlin sur d’autres pages, ni le traité d’argumentation et de patience qui s’était révélé au second visionnage (éclairé par les indications de Tamadon lors d’une interview fleuve que nous publierons en décembre, pour la sortie du film). Troisième visionnage, deux confirmations : l’image, d’abord, est incroyablement soignée, servie par un montage qui fait du rythme des images un contrepoint à la lenteur avec laquelle est employée la parole – puisqu’il s’agit avant tout de garder son calme. Les hommes prennent la pose, quant à l’extrémiste en chef, ce n’est pas s’avancer que d’affirmer qu’il ferait plus de bien à l’humanité en se lançant dans une carrière de méchant à Hollywood. L’autre confirmation, c’est la réussite du final, lorsque le titre s’affiche sur les phares flous symbolisant l’exil forcé du réalisateur, suivi de la dédicace à sa famille. Voilà, j’ai fait tout ce que je pouvais, semblent dire ces deux dernières secondes, mais vous l’avez vu, ces types sont inflexibles – et cet échec, je vous le lègue, je vous l’offre, comme pour vous demander pardon. Surgissent alors toute la force du film, son amertume et son courage. Pendant le festival, Iranien faisait la une d’Allociné, et recevait le soutien de l’ACID. C’est un film d’importance, on lui souhaite la plus belle carrière du monde.
– tout cela sans parler de l’écho des voix parlant farsi dans la salle du Belvédère, bien sûr.




